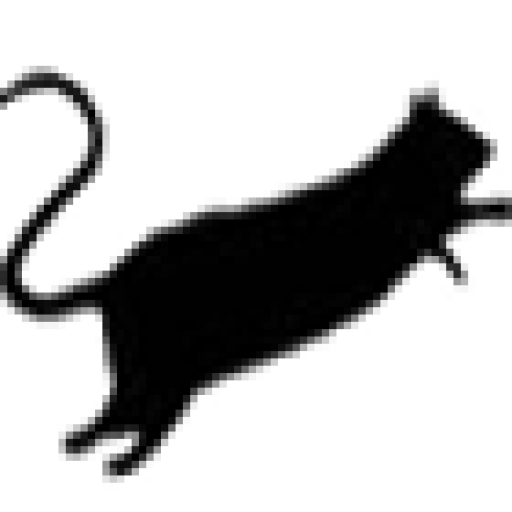LE MANIFESTE DU POCHOIRISME
par Blek le Rat
A l’occasion d’un voyage à New York, en 1971, j’ai vu pour la première fois de ma vie des graffiti artistiques sauvages. Il y en avait une profusion incroyable, dans le métro, sur les murs entourant les terrains de basket, graffitis dessinés au marqueur, signatures nerveuses surmontées d’une couronne, lettrages peints à la bombe, remplis de volutes et de couleurs, omniprésents. J’avais tellement été intrigué par ces enluminures que je me souviens avoir posé la question inévitable:
Mais qu’est ce que cela veut dire et pourquoi tant de gens font-ils ça ?
Blek le Rat
Malheureusement personne ne put me donner une réponse satisfaisante, si ce n’est que c’était l’œuvre de gens irresponsables et irréfléchis. “Une sale vengeance”, avait dit Lindsay, le maire de New York de l’époque. Au même moment à Paris ce mode d’expression était encore à son état latent. Bien sûr il y avait eu en 1968 une masse de revendications politiques et sociales tracées sur les murs de la cité, bien sûr nous avions abordé le sujet de l’art dans la rue à travers les affiches revendicatives créées dans les ateliers populaires de l’École des Beaux Arts, mais il n’existait pas encore un grand mouvement d’artistes décidés à intervenir sur le paysage urbain.
Pourtant, ce mouvement d’art sauvage existait déjà aux USA depuis la seconde moitié des années soixante et des dizaines d’artistes confinés à l’anonymat urbain poussaient le signal d’alarme en écrivant leurs noms d’emprunt sur les murs, à la bombe ou au marqueur.
Ces graffiti sont restés plantés dans ma mémoire et le passage à l’acte a mis dix ans à éclore. Des études de gravure et d’architecture à l’École des Beaux Arts de Paris m’ont familiarisé avec ces techniques. J’apprenais donc, au cours des années soixante-dix, les techniques de l’eau-forte, de la lithographie et de la sérigraphie, en même temps que l’enseignement de l’architecture à l’Unité Pédagogique d’Architecture N° 6 me faisait prendre conscience de l’existence calculée et programmée de l’espace citadin. Au début des années soixante-dix j’étais aussi très influencé par David Hockney qui avait eu une grande exposition proche de l’Ecole des Beaux Arts à Paris. Et je peux dire que son œuvre est la chose la plus impressionante que je n’avais jamais vue auparavant dans ma vie. L’année suivante il faisait un film « The bigger splash » dans lequel il peignait avec des pinceaux et à la peinture à l’huile un grand portait en pied d’un de ses amis sur le mur d’un appartement. Cette image n’a jamais quittée mon esprit. Je considerais ce film si important pour l’histoire de l’art que j’allais le voir dix ou quinze fois.
En 1980 mon copain Gérard animait un terrain d’aventure dans la ville des Ulis, destiné à accueillir des préadolescents pendant les périodes de vacances scolaires. J’intervenais en tant que bénévole sur ce terrain d’aventure. Ce lieu était peuplé de tout un petit monde d’enfants qui venaient dans le but de se rencontrer et de s’occuper, sans qu’aucune autorité ne les entrave dans leurs jeux. Le terrain était situé juste derrière un supermarché et les allers et venues entre les deux lieux se faisaient allégrement. Parmi toutes les babioles ramenées du magasin on pouvait régulièrement trouver des pots de peinture, qui sortaient illégalement de la grande surface et servaient à peindre et à repeindre la cabane dans laquelle nous rangions notre matériel.

De grandes fresques dégoulinantes, qui ne ressemblaient à rien de précis, apparurent et disparurent au fil de l’année sur notre cabane. Ce fut, pour nous deux, une émotion à chaque réaction et nous décidâmes, Gérard et moi, de nous procurions des bombes de peinture, par désir de modernité, car le virus était attrapé. La capitale était à nous, il ne restait plus qu’à agir. La première fois que nous avons graffité, en octobre 1981, nous avions essayé de reproduire un genre de graff américain sur un mur abandonné dans le XIVe arrondissement de Paris, rue des Thermopyles. Ce fut un fiasco. J’ai alors proposé de fabriquer des pochoirs, très ancienne technique, ancêtre de la sérigraphie et plus tard utilisée par les groupes italiens d’extrême droite pour faire leur propagande.
Je me souviens avoir vu l’effigie du Duce casqué au tout début des années soixante, vestige de la deuxième guerre mondiale, au cours d’un voyage que j’avais fait à Padoue, en Italie pendant mon enfance avec mes parents.
La technique était trouvée, le matériel procuré, encore une fois, il fallait agir.

La place était libre et le graffitage était une pratique encore inconnue en ces temps que les flics qui circulaient en voiture ne nous dérangeaient pratiquement pas, si ce n’est pour demander si ce que nous faisions était fait dans un but politique. On leur répondait: « Non c’est de l’art », et le tour était joué. Nous avions pris le nom de BLEK en référence à une bande dessinée en Italie que nous lisions dans notre enfance et qui s’appelait Blek le Rock. Choix d’un pseudonyme car nous avions décidé de rester anonymes, une façon d’interpeller les gens du quartier.

Qui étaient les auteurs de ces petits rats, de ces bananes, de ces bonhommes qui couraient et de tous ces petits pochoirs que nous fabriquions le jour et que nous graffitions la nuit dans le XIVe et dans le XVIIIe arrondissement de Paris?

Nos sorties nocturnes se faisaient de plus en plus rapprochées. A la fin de l’année 82, nous avons décidé, le 31 décembre, de bomber autour du temple consacré à l’art, le Centre Georges Pompidou.
Blek le Rat
Nous avons donc graffité des tas de rats, de tanks et petits personnages sur ce lieu de culte dans la nuit du décembre au 1 er janvier 1983, dans un froid glacial. Des gardiens du musée étaient sortis nous demander ce que nous faisions là. Encore une fois « de l’art » avions-nous répondu, ce qui avait créé un léger sourire sur les lèvres des gardiens du temple. A la fin de l’hiver 83, le couple BLEK se séparait, Gérard, ayant d’autres obligations, je restais seul et pris le nom de BLEK LE RAT.

LE NOM – C’EST LA RELIGION DU GRAFFITI
Norman Mailer
C ‘est par le nom que l’on est reconnu, suivi à la trace, l’image servant de support à ce nom, ce nom qui me disait: « Tu existes pour des milliers de gens que tu ne connais pas et que tu ne rencontreras jamais, mais tu existes dans ce monde refermé à l’anonymat urbain ».
J’avais le pouvoir de créer des images et de les montrer sans pour autant passer par des intermédiaires qui jugeraient mon travail selon leur concept. La liberté en quelque sorte. J’étais seul dans la ville et la ville m’appartenait. Après chaque nuit de graffitage, je repassais régulièrement devant mes murs et je restais parfois des heures entières à regarder mes images et les gens qui passaient. Juste un regard furtif de leur part sur mon graffiti me remplissait de joie. Le nombre de mes pochoirs augmentait rapidement car la vie d’un pochoir est éphémère, vu la façon dont il est traité. La peinture, en séchant, crée une croûte sur le carton et les espaces découpés se referment après les nombreux passages de couleur. Il faut donc faire de nouveaux pochoirs et plus on travaille, plus on affine sa technique, plus ça devient facile et plus les résultats sont satisfaisants.
Maîtrisant donc mieux la technique j’eus l’idée, en mars 1983, de faire un homme grandeur nature. Je trouvais dans le journal Libération la photo d’un vieil homme portant une casquette, photo prise en Irlande du Nord qui me convenait parfaitement pour un pochoir. Ce personnage allait déambuler dans des dizaines de villes de France, laissé comme une trace de mon passage. Il fut appelé Buster Keaton, Charlot, le vieux, il prit une dimension que je n’avais pas prévue au départ. Ce fut une manne pour les photographes et combien de fois je retrouvais des photos de ce personnage dans les journaux,


illustrant des articles dont le sujet n’était pas forcément lié aux graffiti. Ce fut donc un succès et j’entrepris la suite de mon travail avec une foule de personnages qui me correspondaient et avec lesquels je me trouvais une affinité.
Il y eu Tom Waits, un petit garçon en culotte courte, Andy Warhol, Marcel Dassault, la femme et l’enfant, un militaire russe que j’avais bombé aux entrées du périphérique, Mitterrand, un faune, Joseph Beuys, un homme courant et hurlant, deux chiens en plein coït, une femme en porte-jarretelles bombée à l’entrée de la maison de Serge Gainsbourg et dans d’autres lieux appropriés.





Ils étaient mes personnages, et je trouve qu’ils me ressemblaient tous quelque part, ils me présentaient au monde comme une personne se présente à une autre et quand je les peignais j’avais toujours l’impression que je laissais une partie de moi-même sur les murs de toutes les villes du monde dans lesquelles j’ai pu aller.

Pendant l’été 1984 d’autres pochoirs apparurent sur les murs de Paris. Les premiers que je vis étaient signés de Marie Rouffet et de Surface Active. Le dialogue était établi entre nous et les graffiti de ces deux artistes venaient s’ajouter aux miens, clin d’œil entre nous, ce qui ne me déplaisait pas et ce qui activait en moi des tas de songes sur ce nouvel art du langage, des signes que nous possédions déjà en commun.
En même temps que de nouveaux pochoirs fleurissaient sur Paris la répression sournoise commençait à pointer son nez. Les flics devenaient de plus en plus agressifs et ma première arrestation eut lieu dans les Halles. Première garde à vue, premier rapport de police dans un commissariat, premier interrogatoire d’un inspecteur de police admirateur de bande dessinée et qui, heureusement pour moi, ne transmit pas le rapport au parquet. Donc sans suite.
Mais la peur d’être pris devint bien réelle à partir de la fin 84. Je dus connaître à ce moment là les habitudes des flics, étudier leurs allées et venues, leurs jours de sortie et leurs heures de passage et régler mon travail par rapport à ces habitudes. J’apprenais à cacher mon matériel sous les voitures, à faire surveiller par des amis les rues dans lesquelles j’allais travailler, enfin je devais m’habituer à prendre un tas de précautions nécessaires à mes activités qui devenaient de plus en plus illégales. Malgré ce petit jeu invivable le désir de m’exprimer, de peindre était tellement fort que la tension créée par ce cache-cache infini se métamorphosait en un déluge de créativité le moment venu. Car il n’y a rien de plus fort pour moi que de travailler dans la rue au plus profond d’une nuit d’hiver, lorsqu’on a les mains gelées et que seul le cœur brûle de peur.
Je n’ai pas cessé d’avoir peur tout au long de ces années, jusqu’à ce jour d’octobre 1991 où ma peur se concrétisa en un passage au tribunal correctionnel de Paris pour le délit de dégradation de biens appartenant à autrui. J’eus encore une fois la chance de tomber sur un juge bon enfant qui aima mon travail et qui me dit: « Je ne peux pas vous condamner pour ça, c’est trop beau », en montrant la photo du graffiti que mon avocat lui avait confiée.
Le mouvement des graffitistes et des pochoiristes a simplement l’intention de prendre la parole par l’image, paroles destinées aux collectifs, paroles d’amour, paroles de haine, paroles de vie, paroles de mort. C’est une forme de thérapie faisant preuve d’élégance, de raffinement, essayant de remplir les vides de ce monde moderne horrible, de couvrir les espaces urbains par des images qui combleraient de réjouissance la vue des passants au petit matin lorsque ceux-ci se dirigent vers leurs labeurs.
Mais les autorités réagissent d’une façon implacable, déclarant la guerre aux graffitis, utilisant tout le panel possible des lois, faisant planer au-dessus des têtes des jeunes artistes des punitions dont la dimension n’est pas à la taille de leurs méfaits, les menaçant d’amendes gigantesques. Comme si la ville avait plus à redouter des graffitis que de la drogue. Mais le désir de s’exprimer et de peindre est tellement fort que les artistes prennent le relais, et cela dans le monde entier, faisant de cet art urbain le mouvement d’art le plus important du siècle quant à sa profusion d’images, quant à l’authenticité qu’il dégage et quant au nombre de ses participants. Il n’existe plus d’agglomérations au monde où les artistes n’interviennent pas sur les murs. Même à Pékin, sous le régime le plus féroce de la planète, un homme est en train en ce moment de laisser sa trace.
Malgré tout cela on considère encore cet art urbain comme une lèpre qui prolifère. Pour moi c’est plutôt la métropole qui fleurit d’intentions poétiques animée par les couleurs de nos bombes aérosol.